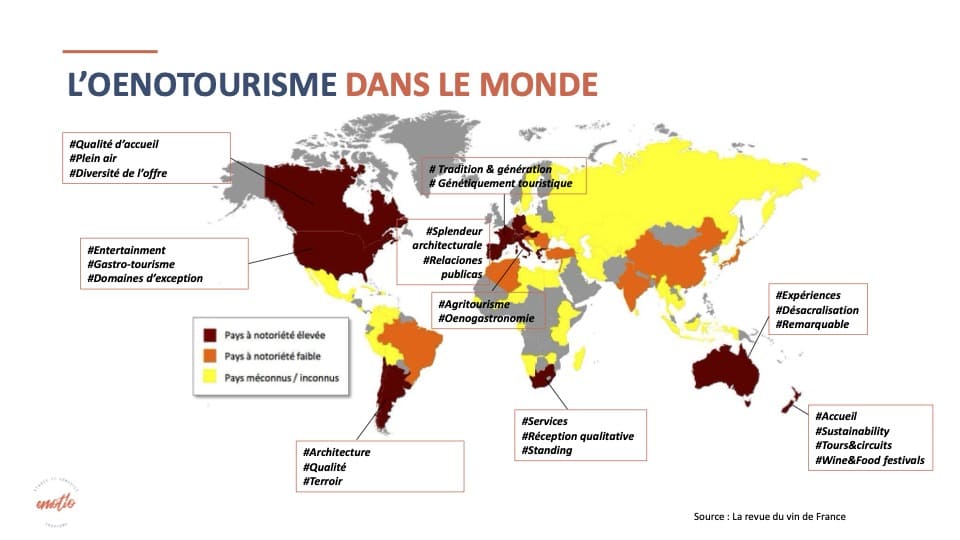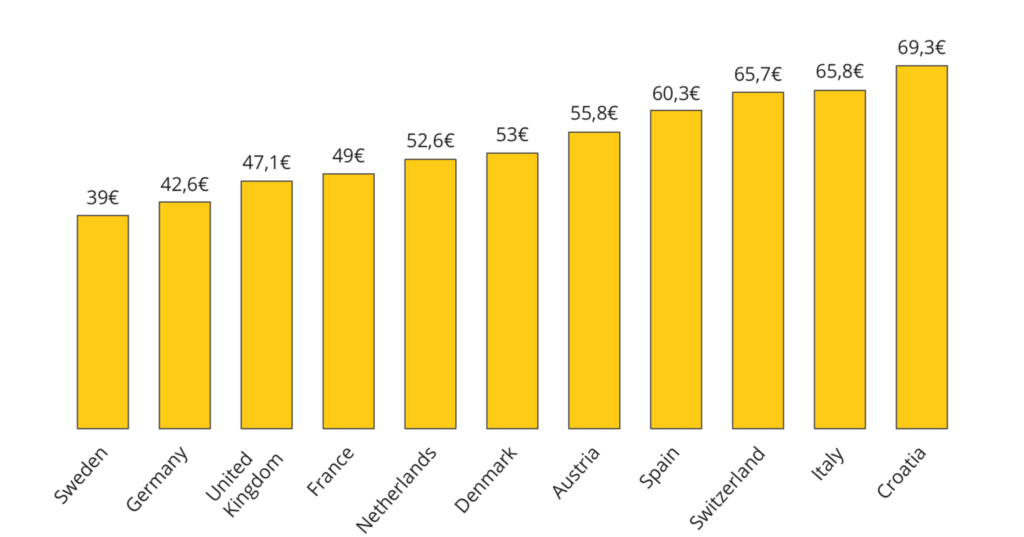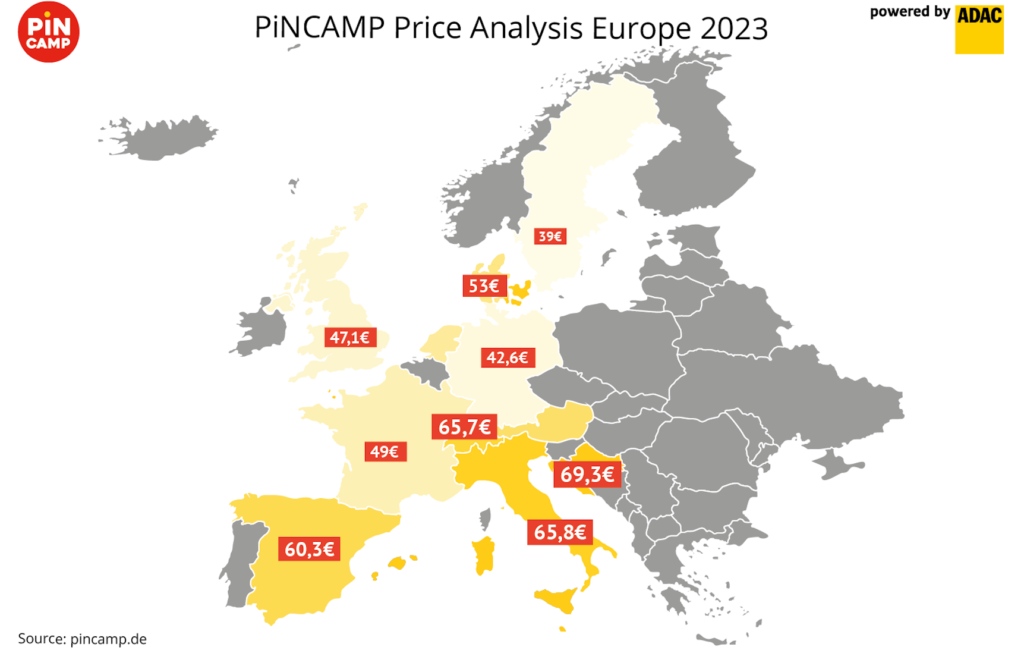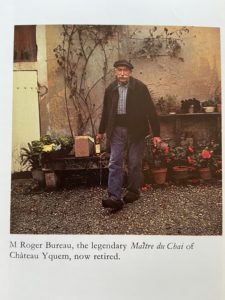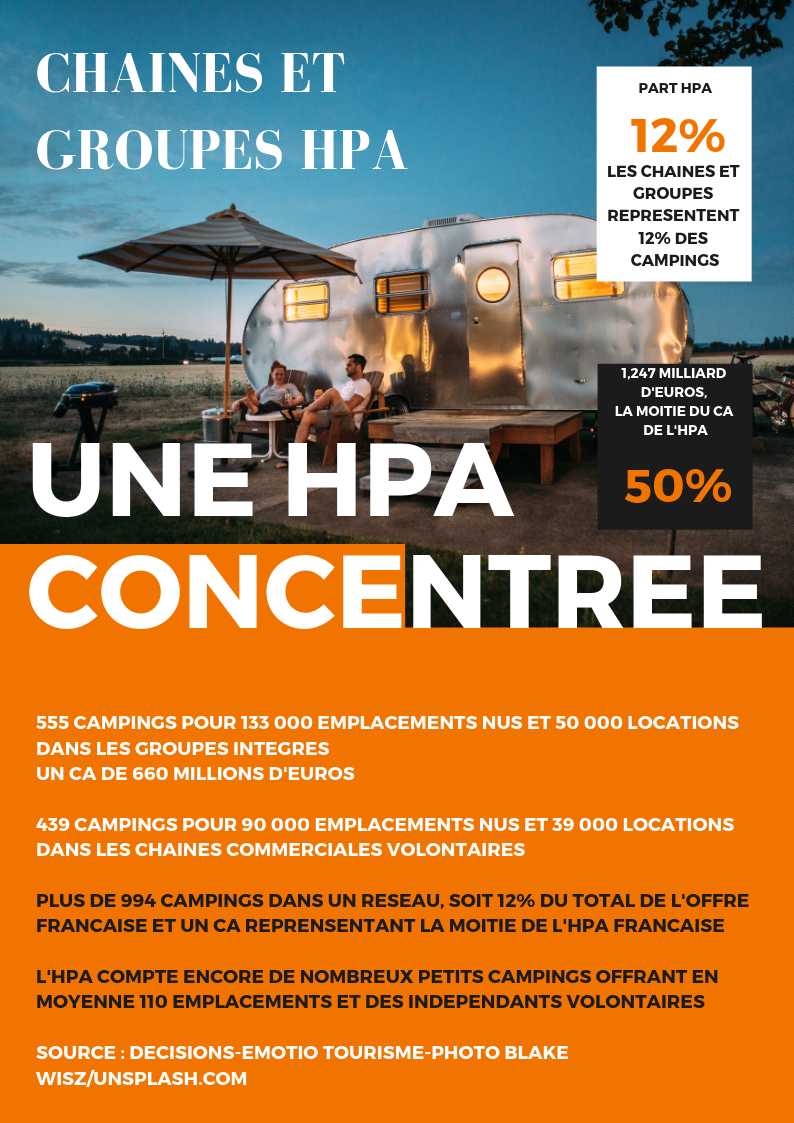Mariage réussi de l’innovation viticole et du tourisme
La viticulture à Lanzarote est un exemple de développement durable et d’adaptation à un environnement naturel unique qu’il convient d’observer. Et ça tombe bien car l’île développe un tourisme particulier autour de ses côtes magnifiques, de ses volcans, de la randonnée et de sa célébrité artistique inspirée, César Manrique. Depuis sa création, Emotio Tourisme suit et accompagne le développement de l’œnotourisme en France et ailleurs. Suivez-nous à la découverte d’un œnotourisme à la fois vulgarisateur et scientifique.
L’île de Lanzarote a une superficie d’environ 845 km2 et est recouverte aux trois quarts avec de la lave produite par plus de trois cents cratères issus d’une centaine de volcans. Située à 140 km de l’Afrique, Lanzarote bénéficie d’un climat stable, avec une température moyenne de 23°C. Car à Lanzarote, s’il ne pleut pas souvent, 13 jours par an, il vente toujours. Les vignobles cultivés dans les sols volcaniques de l’île offrent des paysages saisissants que l’on qualifie facilement de lunaires. En 1964, cet environnement exceptionnel a été reconnu comme une œuvre d’art lors de l’exposition photographique « L’architecture sans architectes » au MoMa de New York.

Des vignes au ras du sol
Les principales zones viticoles de l’île se trouvent dans les régions de La Geria, Masdache et Tinajo, qui englobent les communes de Yaiza, Tías, San Bartolomé et Tinajo. Ce sont là que se déploie le contraste brutal entre les sols volcaniques noirs de Lanzarote et le vert vif des vignes. La singularité du vignoble de l’île réside dans ces murs en pierre volcanique érigés autour des pieds de vigne, qui protègent les plants des vents persistants. Le sol volcanique offre une protection thermique efficace, conservant les minéraux, véritables nutriments et l’humidité apportée par les nuages, essentiels à la culture de la vigne.
L’histoire viticole de Lanzarote remonte au XVIIIème siècle, avec la fondation de la Bodega El Grifo. Les débuts de la viticulture ont été difficiles en raison des éruptions volcaniques qui ont ravagé les cultures. Les dernières éruptions majeures ont eu lieu durant six ans, du 1er septembre 1730 au 16 avril 1736 et ont recouvert environ 167 km2 de Lanzarote, soit environ 20% de l’île. Depuis, une vingtaine de domaines ont ouvert et sont inscrits à la DOP de Vinos, l’organisme en charge du contrôle de l’origine : La Geria, Vega de Yuco, Tisalaya, La Mareta, Titerok. Aujourd’hui, les vignobles couvrent près de 3000 hectares, principalement dans les vallées de La Geria et de Masdache et les vins de l’île bénéficient d’une appellation d’origine depuis 1993.
Des isolats de concentration
Les vignes poussent dans des trous appelés « hoyos », entourés de petits murs circulaires de pierres sèches appelés « socos », qui les protègent du vent. Ces trous peuvent atteindre 3 mètres de profondeur et 10 mètres de diamètre, en fonction de l’épaisseur du « picón », le sol de gravier qui retient l’humidité apportée par les alizés : plus la couche fertile est importante, plus les trous sont profonds et larges. Dans les secteurs où le picón est moins épais, dans la région de Masdache, les trous sont moins profonds et les plantations se font en tranchées. Les murs sont rectilignes, ce qui permet la mécanisation de l’exploitation. Les travaux viticoles sont manuels en raison de ce système de plantation qui inclut également l’irrigation. Les vendanges, souvent dès juillet, sont parmi les premières d’Europe. Mais depuis peu, en raison du changement climatique on teste des vendanges en mars.

Un bel exemple de hoyo
Un récent article du Monde rapporte que sur le site de la Playa Quemada « 1 800 plants de raisns sont récoltés en mars. Outre la Playa Quemada, quatre parcelles réparties dans plusieurs vignobles sont concernées par l’expérience, qui a débuté en 2022 et qui se poursuit en 2024. L’échantillon est modeste rapporté aux terres viticoles de Lanzarote ». Le domaine el Grifo, créé en 1775 est à la manœuvre, avec l’appui d’une partie des petits producteurs.La solution consiste à tailler tôt, juste après les mois d’été, pour que la vigne reparte plus vite, de faire surgir et mûrir le raisin dès les mois d’automne et d’hiver. Un autre avantage surgit : la vigne fleurit et donne du raisin durant les périodes les plus humides, les plus fraîches aussi, limitant l’ajout d’eau et de produits phytosanitaires.

Un magnifique soco
Un cep, une bouteille
Dans l’ensemble de l’île, la densité de plantation moyenne est de 400 et 600 pieds par hectare et les rendements oscillent entre 1 000 et 1 500 kg/ha (soit entre 6 et 10 hl/ha, ce qui équivaut à une bouteille de 0,75 litre par cep). Soit une production d’environ 2 millions de litres dans l’île.
On trouve des vignes bicentenaires sur l’île, qui a été épargnée par le phylloxéra au XIXème siècle. Le greffage n’y est donc pas nécessaire. On cultive ici des cépages qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Par exemple, le Listán Negro, présent sur d’autres îles de Canaries et qui permet d’élaborer des vins rouges aux arômes de fruits rouges et de figue sèche. Mais le blanc domine car le cépage le plus planté est la Malvasía Volcánica, un cépage autochtone à Lanzarote, possiblement issu d’un croisement entre une variété de Malvoisie et le Marmajuelo (un autre cépage autochtone des Canaries) ou originaire de Madère. La Malvasía Volcánica est résistante à la sécheresse, aux fortes températures et au vent. Elle donne de faibles rendements, des raisins à l’acidité élevée, aux arômes floraux et fruités. Elle permet d’élaborer tous les styles de vin blanc : mousseux, sec, demi-sec et liquoreux, avec des vendanges très tardives comparées aux premiers raisins récoltés.

Des vins blancs minéraux et fruités
C’est tout cela que peuvent découvrir les touristes présents sur l’île, soit environ 3 millions par, dont beaucoup séjournent dans les zones balnéaires du Sud-Est. L’eau si manquante provient d’usine de désalinisation de l’eau de mer. Les autorités veulent augmenter la capacité de l’aéroport, pourtant déjà bien important. Ici la randonnée volcanique est captivante, comme le sont les domaines viticoles, aux équipes ingénieuses pour s’adapter encore et toujours aux risques volcaniques et climatiques. Les accueils dans les domaines sont gratuits pour une visite impromptue mais simple et payante, le plus souvent aux environs de 15 euros par adulte pour une visite et dégustation en groupe, en espagnol et en anglais. Yuco, à la belle bouteille bleu se caractérise par une expérience de 90 minutes vendues 22 euros. L’œnotourisme ici est bien engagé, il apporte une touche adaptative au monde de bon aloi.
Il reste à concevoir un œnotourisme à la médiation plus armée sur cette capacité d’adaptation aux contraintes par l’innovation.